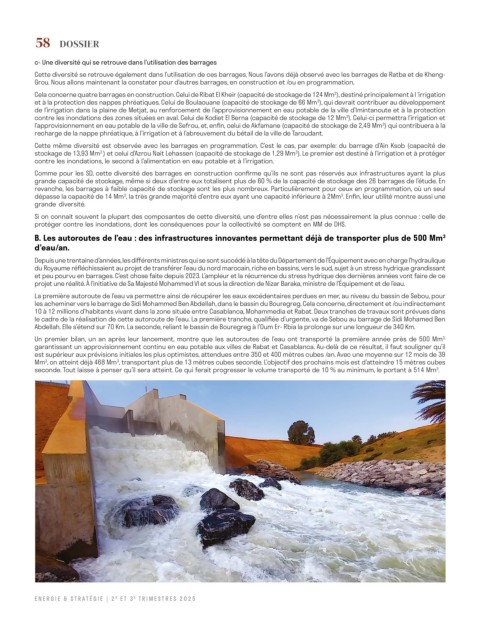Page 58 - Revue Energie & Stratégie N° 70
P. 58
58 DOSSIER
c- Une diversité qui se retrouve dans l’utilisation des barrages
Cette diversité se retrouve également dans l’utilisation de ces barrages. Nous l’avons déjà observé avec les barrages de Ratba et de Kheng-
Grou. Nous allons maintenant la constater pour d’autres barrages, en construction et /ou en programmation.
3
Cela concerne quatre barrages en construction. Celui de Ribat El Kheir (capacité de stockage de 124 Mm ), destiné principalement à l ‘irrigation
3
et à la protection des nappes phréatiques. Celui de Boulaouane (capacité de stockage de 66 Mm ), qui devrait contribuer au développement
de l’irrigation dans la plaine de Metjat, au renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Imintanoute et à la protection
3
contre les inondations des zones situées en aval. Celui de Kodiet El Berna (capacité de stockage de 12 Mm ). Celui-ci permettra l’irrigation et
l’approvisionnement en eau potable de la ville de Sefrou, et, enfin, celui de Akfamane (capacité de stockage de 2,49 Mm ) qui contribuera à la
3
recharge de la nappe phréatique, à l’irrigation et à l’abreuvement du bétail de la ville de Taroudant.
Cette même diversité est observée avec les barrages en programmation. C’est le cas, par exemple: du barrage d’Ain Ksob (capacité de
3
3
stockage de 13,93 Mm ) et celui d’Azrou Nait Lehassen (capacité de stockage de 1,29 Mm ). Le premier est destiné à l’irrigation et à protéger
contre les inondations, le second à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation.
Comme pour les SD, cette diversité des barrages en construction confirme qu’ils ne sont pas réservés aux infrastructures ayant la plus
grande capacité de stockage, même si deux d’entre eux totalisent plus de 60 % de la capacité de stockage des 26 barrages de l’étude. En
revanche, les barrages à faible capacité de stockage sont les plus nombreux. Particulièrement pour ceux en programmation, où un seul
3
dépasse la capacité de 14 Mm , la très grande majorité d’entre eux ayant une capacité inférieure à 2Mm . Enfin, leur utilité montre aussi une
3
grande diversité.
Si on connait souvent la plupart des composantes de cette diversité, une d’entre elles n’est pas nécessairement la plus connue : celle de
protéger contre les inondations, dont les conséquences pour la collectivité se comptent en MM de DHS.
B. Les autoroutes de l’eau : des infrastructures innovantes permettant déjà de transporter plus de 500 Mm 3
d’eau/an.
Depuis une trentaine d’années, les différents ministres qui se sont succédé à la tête du Département de l’Équipement avec en charge l’hydraulique
du Royaume réfléchissaient au projet de transférer l’eau du nord marocain, riche en bassins, vers le sud, sujet à un stress hydrique grandissant
et peu pourvu en barrages. C’est chose faite depuis 2023. L’ampleur et la récurrence du stress hydrique des dernières années vont faire de ce
projet une réalité. À l’initiative de Sa Majesté Mohammed VI et sous la direction de Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’eau.
La première autoroute de l’eau va permettre ainsi de récupérer les eaux excédentaires perdues en mer, au niveau du bassin de Sebou, pour
les acheminer vers le barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah, dans le bassin du Bouregreg. Cela concerne, directement et /ou indirectement
10 à 12 millions d’habitants vivant dans la zone située entre Casablanca, Mohammedia et Rabat. Deux tranches de travaux sont prévues dans
le cadre de la réalisation de cette autoroute de l’eau. La première tranche, qualifiée d’urgente, va de Sebou au barrage de Sidi Mohamed Ben
Abdellah. Elle s’étend sur 70 Km. La seconde, reliant le bassin de Bouregreg à l’Oum Er- Rbia la prolonge sur une longueur de 340 Km.
Un premier bilan, un an après leur lancement, montre que les autoroutes de l’eau ont transporté la première année près de 500 Mm 3,
garantissant un approvisionnement continu en eau potable aux villes de Rabat et Casablanca. Au-delà de ce résultat, il faut souligner qu’il
est supérieur aux prévisions initiales les plus optimistes, attendues entre 350 et 400 mètres cubes /an. Avec une moyenne sur 12 mois de 39
3
Mm , on atteint déjà 468 Mm , transportant plus de 13 mètres cubes seconde. L’objectif des prochains mois est d’atteindre 15 mètres cubes
3
seconde. Tout laisse à penser qu’il sera atteint. Ce qui ferait progresser le volume transporté de 10 % au minimum, le portant à 514 Mm . 3
E
E
ENERGIE & STRA TÉGIE | 2 E T 3 TRIMESTRES 2025