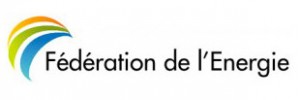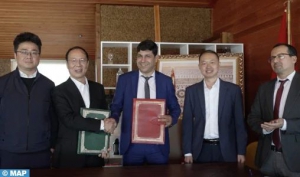Les opportunités des énergies renouvelables et les enjeux du changement climatique, ont été au centre d’une rencontre tenue, le 29 octobre à Laâyoune, en présence d’un parterre d’experts et d’acteurs institutionnels et associatifs.
Organisée par le Réseau Association Khnifiss et la Coordination régionale de l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) à Laâyoune-Sakia El Hamra, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de la COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan en novembre prochain et la campagne méditerranéenne “TeraMed” qui vise à accélérer une transition énergétique équitable dans la perspective de redoubler la production d’énergie propre d’ici l’année 2030.
Placée sous le thème “Les opportunités et les enjeux des énergies renouvelables et du changement climatique et le renforcement du processus de la durabilité dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra: Quel rôle pour +Teramed+”, cet événement intervient également dans le cadre des efforts nationaux et régionaux ayant pour objectif de faire face aux répercussions des changements climatiques et de contribuer à la mise en œuvre des résultats des différentes conférences des parties à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
S’exprimant à cette occasion, le coordinateur régional de l’AMCDD, Salek Aouissa, a indiqué que cette rencontre a pour but de mettre en exergue l’initiative “TeraMed”, de débattre des défis et des obstacles auxquels est confrontée la transition vers les énergies renouvelables, et d’identifier les opportunités d’investissement en la matière.
Aouissa, qui est également président du Réseau Association Khnifiss, a souligné que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra s’est adhéré au processus de la mise en œuvre d’un plan régional de neutralité carbone et de transition vers les énergies propres.
La région abrite les plus grandes centrales d’énergies renouvelables au niveau africain, favorisant ainsi le processus de développement vers la neutralité carbone, la réalisation de projets sans pollution et une intégration optimale des dimensions climatiques et de la gestion durable des ressources et des systèmes et leur préservation dans le cadre des programmes et plans de développement.
Dans ce contexte, l’acteur associatif a souligné l’impératif de l’échange d’expériences, d’expertises et de recherches, appelant à trouver des solutions et à renforcer le dialogue entre tous les acteurs territoriaux, les départements gouvernementaux et le secteur privé, en vue d’assurer la transition vers la neutralité carbone, le développement durable et les industries vertes.
Pour sa part, Ayoub Doughmi, ingénieur à la Direction régionale de l’environnement a présenté un exposé sur la Stratégie nationale de Développement durable, qui ambitionne notamment d’assurer une transition vers une économie verte et inclusive d’ici 2030 en définissant des objectifs ambitieux, en termes de développement des énergies renouvelables (plus de 52% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030) et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Doughmi a aussi passé en revue les différents projets régionaux en énergies renouvelables (énergie æoline, énergie solaire et l’initiative hydrogène vert).
De même, les participants ont été conviés à suivre une présentation sur l’initiative “Terramed” visant à soutenir le dialogue méditerranéen pour l’augmentation du volume des énergies renouvelables afin de répondre aux défis du changement climatique, parvenir à la neutralité carbone et atteindre les objectifs de l’accord de Paris dans les pays du Bassin Méditerranéen.
Lors de cette rencontre, une série de thématiques ont été débattues axées notamment sur “Les énergies renouvelables et le changement climatique et leur impact sur l’économie et la société”, “Le rôle de la technologie dans le développement des sources d’énergie renouvelables”, “Les efforts et initiatives nationaux dans le domaine des énergies renouvelable” et “L’investissement dans les projets d’énergies renouvelables”.
Organisée en partenariat avec l’association Le Club marocain pour l’environnement et le développement et en coopération avec la Direction régionale de l’environnement, le Réseau Arabe pour l’environnement et le développement (READ), l’Alliance pour le climat et l’air pur et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, cette rencontre a été marquée par la présence des représentants institutionnels, des élus, des représentants du secteur privé, des universitaires, des étudiants et des acteurs de la société civile.