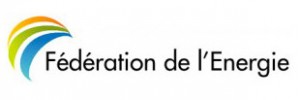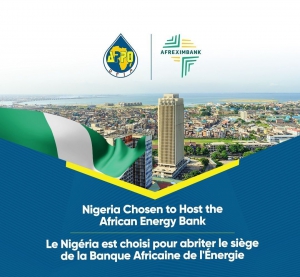Dans un contexte international marqué par la surconsommation et le gaspillage de masse, la planète fait face à un défi de taille : transformer la problématique des déchets en un levier de développement économique et social respectueux de l’environnement.
Avec une croissance démographique rapide et une urbanisation galopante, la production de déchets a considérablement augmenté ces dernières années, engendrant des défis majeurs, notamment en matière de collecte, de traitement et de recyclage.
Selon le rapport “Global Waste Management Outlook 2024”, publié par le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE), la production mondiale de déchets solides municipaux devrait passer de 2,1 milliards de tonnes en 2023 à 3,8 milliards de tonnes d’ici 2050.
Cette augmentation considérable entraînera une flambée des coûts de gestion des déchets, qui pourraient atteindre 640,3 milliards de dollars d’ici 2050, contre 361 milliards en 2020, si aucune mesure corrective n’est adoptée.
Face à cette situation alarmante, la Journée internationale du zéro déchet, qui coïncide avec le 30 mars, constitue une occasion idoine pour sensibiliser sur l’importance de repenser notre modèle de consommation et jeter la lumière sur les nouvelles stratégies de gestion des déchets et les solutions innovantes en matière de recyclage.
“Nous devons agir pour éviter le scénario du pire”, alerte la directrice du PNUE, Inger Andersen, mettant en avant le rôle clé des acteurs publics et privés dans la réduction drastique des détritus en investissant davantage dans l’économie circulaire.
En effet, la mise en place d’une économie circulaire, où les déchets sont revalorisés plutôt que jetés, représente une opportunité pour tous les pays afin de contribuer aux objectifs de durabilité, tout en stimulant l’innovation et la création d’emplois.
Dans ce sillage, l’ONU insiste sur l’importance d’adopter de meilleurs modes de traitement des déchets en vue de limiter les coûts nets annuels à 270,2 milliards de dollars d’ici 2050, voire générer un gain net de 108,5 milliards de dollars par an. Conscient des enjeux majeurs liés à l’assainissement solide, le Maroc a placé depuis plusieurs années la valorisation et le recyclage des déchets au centre de ses politiques publiques, avec l’ambition de réduire la pression sur les ressources naturelles et atténuer les effets néfastes de la pollution sur la santé et l’environnement.
Ainsi, des initiatives telles que le Programme national de gestion des déchets ménagers (PNDM), ont permis de concrétiser de nombreux objectifs, notamment l’augmentation du taux de collecte des déchets ménagers et assimilés à 96%, contre seulement 44% en 2008.
Dans le cadre de ce programme, il a été également procédé à la mise en place de centres d’enfouissement et de valorisation (CEV), à la réhabilitation ou la fermeture de décharges sauvages, ainsi qu’à la modernisation du secteur des déchets à travers la professionnalisation du secteur.
De même, un protocole sur la valorisation des déchets ménagers a été signé récemment par les ministères de l’Intérieur, de la Transition énergétique et du Développement durable, de l’Industrie et du Commerce, et de l’Économie et des Finances, visant à porter le taux de valorisation à 25% à l’horizon 2030 et à réduire de 45% la quantité de déchets enfouis.
Cet élan s’est également manifesté au niveau régional, notamment avec la signature, lors des dernières Assises nationales sur la régionalisation avancée, d’une convention-cadre d’un coût total de 27 milliards de dirhams, entre le gouvernement et les douze Conseils régionaux, relative à la gestion du secteur des déchets ménagers et assimilés sur la période 2025-2034.
Pour accompagner cette dynamique vertueuse enclenchée par le Royaume, la Banque mondiale a approuvé en 2024 le Programme d’appui à la gestion des déchets ménagers et assimilés (GDMA), d’un montant de 250 millions de dollars.
Toutefois, aussi ambitieux soient les investissements et les politiques publiques déployés pour assurer une meilleure gestion des déchets, leur impact réel reste tributaire de l’engagement quotidien des citoyens, à travers l’adoption de gestes simples tels que le tri, la réduction des déchets et la réutilisation.
En repensant nos modes de consommation et en favorisant le recyclage et l’économie circulaire, nous pouvons limiter notre impact environnemental et construire un monde plus sain pour les générations futures.